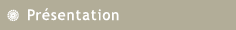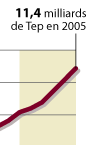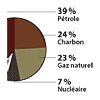|
|

| |
|
|
 La « crise pétrolière » a réapparu. Les pronostics sur la disponibilité du pétrole se contredisent, mais comme le monde réclame de plus en plus d'énergie, une question surgit : Le pétrole va-t-il se raréfier bientôt et son prix grimper, grimper ?
On peut voir cette question sous l'angle matérialiste, sous l'angle spirituel ou sous l'angle réaliste, que nous préférerons. Le réalisme est le lieu où spiritualité et matérialisme se chevauchent, l'homme spirituel étant aussi charnel et légitimement industrieux et industriel.
Très intéressant domaine de méditation. Ici, un lien étroit lie le matériel au spirituel. La « crise pétrolière » a réapparu. Les pronostics sur la disponibilité du pétrole se contredisent, mais comme le monde réclame de plus en plus d'énergie, une question surgit : Le pétrole va-t-il se raréfier bientôt et son prix grimper, grimper ?
On peut voir cette question sous l'angle matérialiste, sous l'angle spirituel ou sous l'angle réaliste, que nous préférerons. Le réalisme est le lieu où spiritualité et matérialisme se chevauchent, l'homme spirituel étant aussi charnel et légitimement industrieux et industriel.
Très intéressant domaine de méditation. Ici, un lien étroit lie le matériel au spirituel.

|
|
| |

|
|
On parle de carburant à 3, 4,
5 et même 6€. En fait, si l’essence coûtait 6€, elle n’existerait simplement
plus, parce que personne ne pourrait payer ce prix pour rouler. Restons-en à ce
qui existe et à ce qui est réellement prévisible.
En dollars constants le
pétrole brut, l’or noir, a été plus cher qu’aujourd’hui, mais en dollars
courants son coût — entre $ 53 et $57 le baril !— a de fâcheuses conséquences sur notre porte-monnaie.
Nous payons de plus en plus cher le carburant à la pompe, le fuel de chauffage,
mais aussi le kilowatt/heure, le ciment, l’acier et même le pain, dont les
fabrications utilisent directement ou indirectement l’énergie pétrolière.
La « crise pétrolière » a réapparu. Les pronostics sur la disponibilité du pétrole se
contredisent, mais comme le monde réclame de plus en plus d’énergie, une
question surgit : Le pétrole va-t-il se raréfier bientôt et son prix
grimper, grimper ?
On peut voir cette question
sous l’angle matérialiste, sous l’angle spirituel ou sous l’angle réaliste, que
nous préférerons. Le réalisme est le lieu où spiritualité et matérialisme se
chevauchent, l’homme spirituel étant aussi charnel et légitimement industrieux
et industriel.
Très intéressant domaine de
méditation. Ici, un lien étroit lie le matériel au spirituel. On pense
simultanément à trois choses :
D’une part, la menace de
pénurie en denrées et matières premières.
D’autre part, la culture
matérialiste dominante en Occident industrieux, mais qui commence à dominer
l’Orient et le Sud.
Et enfin, l’intention
qu’avait le créateur en créant les ressources énergétiques dont auraient besoin
les hommes, soit directement par le rayonnement solaire, eau, vent, uranium,
etc., soit indirectement par l’évolution (création lente) qui engendrerait
d’autres ressources énergétiques : charbon, pétrole, etc. L’intention du
créateur fut très simple : Faire à Adam un don total de la terre et de
tout ce qu’elle porte ou contient (Genèse 1/28-30) sans autre
restriction que celle du fameux fruit d’un certain arbre non physique,
mais métaphysique : l’arbre de la connaissance du bien et du mal
(Genèse 2/17). Aucune restriction matérielle, aucun dosage de la
consommation, donc. Le créateur, des milliers d’années plus tard, le
confirmerait à Noé et à ses fils : Je vous donne tout, avec
une seule restriction, cette fois encore de nature métaphysique : la vie, que symbolise le sang qui circule (Genèse 9/1-6). Rien n’oblige à
matériellement se restreindre. Par application de la mesure (Rév.
d’Arès 7/6-7, 25/9, 32/10) ? Mais cette mesure concerne
seulement l’ascension vers les Hauteurs, c.àd. l’évolution spirituelle
de l’individu comme du monde. Dans le domaine de la consommation matérielle, de
l’énergie notamment, la mesure ne peut être qu’un principe de raison auquel
pensent même les athées matérialistes qui ne lisent pas l’Écriture.
Comme on le voit, pour des
croyants la question de la consommation comme du profit matériels est
spirituellement sans réponse de la Parole. Autrement dit, à cette question
chacun peut apporter sa réponse. Ces lignes donnent une réponse parmi d’autres
possibles, réponse que peuvent nier sans trahir leur foi d’autres
Pèlerins d’Arès qui sont écologistes, soixante-huitards, etc.
|
|
 |
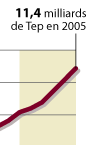
 La consommation mondiale en énergie augemente, mais reste stable par individu. La consommation mondiale en énergie augemente, mais reste stable par individu.
|
 |
La plupart des observateurs
pensent que le pétrole restera cher. Même si les prix baissent momentanément,
la fièvre reprendra. Pourquoi ? Simplement parce que la consommation
mondiale d’hydrocarbure augmente plus rapidement que sa production, réelle ou
prévisible. Le déséquilibre défavorable entre l’offre et la demande risque fort
de durer et de s’aggraver.
Concernant le pétrole
immédiatement disponible, les analystes semblent unanimes sur un point :
L’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) ne dispose que de
ressources résiduelles très faibles : Un million de barils/jour. Presque
rien. Concrètement, cela signifie que si la demande quotidienne dans le monde,
actuellement de 82 millions de barils/jour, passe à 83 millions de barils/jour,
l’OPEP peut encore fournir, mais que si elle passe à 84 millions de barils/jour,
la pénurie commence en attendant que de nouvelles exploitations soient mises en
marche. Le monde dispose donc seulement de 1/82ème, soit 1,22 %
de ressources excédentaires. Si, dans cette situation hypertendue, un seul
producteur comme l’Algérie, l’Angola ou l’Indonésie, dont la production est
approximativement d’un million de barils/jour, subit un ralentissement
technique de sa production ou ferme ses vannes pour des raisons politiques, il
n’y a plus de réserves disponibles et les cours montent. Ils montent, parce que
la peur de manquer saisit les consommateurs d’énergie et fait monter les
enchères. C’est ainsi que les dégâts causés aux plates-formes pétrolières du
Golfe du Mexique par l'ouragan Ivan ou encore une grève de quatre jours au
Nigeria (2,5 millions barils/jour) ont fait monter le cours du brut en 2004.
Les hommes, on le voit,
consomment presque tout ce dont ils disposent. Peut-on le leur reprocher ?
La cupidité n’explique pas la consommation, contrairement à ce poncif, parmi
d’autres : « La terre peut sans problème satisfaire les besoins de
tous les hommes, mais elle ne peut satisfaire leur cupidité », où l’on
voit que Gandhi, qui était aussi politicien, se faisait parfois de la réclame
en moralisant facilement. La consommation pétrolière a d’autres causes,
complexes. Citons-en une seule, qui est de taille : L’industrialisation de
pays récemment encore peu industrialisés (Chine, Inde, etc.), dont les besoins
d’énergie croissent plus que rapidement, expéditivement. La ponction pétrolière
croît de même expéditivement, parce que le pétrole est une source d’énergie
vite utilisable contrairement à d’autres sources d’énergie qui demandent, comme
le nucléaire, la formation lente d’ingénieurs et physiciens capables, l’étude
lente d’installations puissantes mais complexes et délicates, la création
d’industries connexes (séparation des isotopes, recyclage des matières
fissibles, etc.), bref, de longues préparations. Par là on voit que,
matériellement parlant, la question la plus importante que pose le pétrole
est : Durera-t-il assez longtemps pour que les pays nouvellement
industrialisés se préparent à l’utilisation d’autres énergies : nucléaire
pour l’électricité de masse, hydrogène pour les moteurs à explosion, éolienne
et photovoltaÏque (panneaux solaires) pour l’électricité locale, etc.
|
 |
| |

 De gros écarts de consommation d'un continent à l'autre. De gros écarts de consommation d'un continent à l'autre.
|
|
Au delà de périodes de
rémission, où la demande de pétrole se stabilisera ou baissera un peu, il y a
fort à parier que le déséquilibre entre offre et demande ira en s’accentuant,
de toute façon. Pour la simple raison que le pétrole est une ressource de
quantité finie, c.àd. non renouvelable, tandis que la consommation
industrielle, du fait de la créativité humaine sans limites, est inversement de
plus en plus demandeuse.
On ne peut pas reprocher à
l’humanité sa créativité, partie intégrante de l’image et ressemblance du Créateur (Genèse 1/27). Peut-on alors lui reprocher son manque de mesure
et douceur (Rév. d’Arès 25/9) dans l’organisation, souvent dans la
bousculade, de la production massive de ce qu’elle crée, surtout depuis un
siècle et demi ? Peut-on reprocher aux Africains et aux Asiatiques de
vouloir se donner ce que se sont déjà donné les Européens ? Et même en
Europe peut-on reprocher à la demande populaire de biens techniques d’augmenter
et par ce fait d’augmenter la consommation de l’énergie qu’exige leur
production ? Peut-on lutter contre le chômage et les bas salaires et
réduire le travail dans les usines productrices de produits de bon rapport,
mais grosses consommatrices d’énergie ? Quant aux biens personnels, on
ignore complètement quels effets négatifs auraient sur la masse humaine nantie
la restriction d’électricité, de carburant, etc. Pas plus que les populations
soumises aux restrictions pendant la guerre de 1940-45, ils n’auraient la
béatifique impression d’être sauvés de la « cupidité ». On entrevoit
ici quelques dilemmes et quelques dangers d’un rationnement du pétrole,
possible à moyen terme.
La raison ne peut pas donner
de réponse morale et juste à ces questions. L’imagination ne le peut pas
davantage, sauf fiction à la « Mad Max » — film ou les hommes
s’entretuent pour un fût de gas-oil —, dont les probabilités de vraisemblance
sont inconnues. Comment inventer une réponse, quand nous vivons dans un
processus inverse à toute idée de pénurie et que notre cerveau, malgré lui, va
dans le même sens. Dans les pays industrialisés l’accélération des progrès
sociaux, de la féodalisation par les services de l’état de plus en plus
coûteux, etc., a poussé, à tort ou à raison, ceux qu’on contraint à payer les
taxes nécessaires à ces lourds budgets à accélérer leurs entreprises, leurs
industries, leurs commerces, à inventer et produire toujours davantage.
Personne n’envisage que ces budgets sociaux et administratifs ne diminuent et
même tout le monde demande davantage. Ailleurs, on ne peut pas reprocher aux
habitants de pays technologiquement attardés leur fièvre à s’électrifier,
s’équiper, se véhiculer, se soigner, avoir une retraite, etc. Les compagnies
pétrolières et les états qui les taxent lourdement gagnent, certes, beaucoup
d’argent, mais le pétrole n’est pas une gabelle, on n’en vend pas plus aux
citoyens qu’il n’en demandent — Le fuel ou l’essence n’a pas plus besoin de
publicité pour se vendre que l’air n’en aurait pour être respiré —.
Alors ? Le spirituel peut-il donner une réponse plus facile à une question
matériellement très difficile ? Plus d’un théologien ou philosophe
reculerait devant le sujet.
C’est vrai qu’on ne peut pas
dire grand chose de direct philosophiquement ou spirituellement, sinon par
exemple ceci, a contrario : Impossible d’imposer à l’humanité par
la contrainte une solution spirituelle à la pénurie de pétrole, parce que la
contrainte est contraire à la spiritualité même. Tout aussi impossible, dans
l’état actuel du monde, serait une réponse spirituelle volontaire aussi
longtemps que la mission des Pèlerins d’Arès n’aura pas sensibilisé
spirituellement un petit reste. La laïcité est renoncement à la
religion, c’est bien, mais elle est, hélas, devenue aussi renoncement à la vie
spirituelle. Le monde n’est pas prêt à envisager ce type de réponse.
On ne peut que survoler
virtuellement, gratuitement, l’aspect spirituel du problème. C’est gratuitement
qu’on peut, par exemple, déclarer imprévoyante, voire folle, la politique qui,
dans le domaine de la consommation, a ignoré les valeurs spirituelles :
l’amour du prochain, la sagesse, etc. C’est tout aussi gratuitement
qu’on peut dire qu’il aurait fallu, d’une part, encourager le ralentissement de
l’inventivité et de la consommation d’énergie qui en a résulté et, d’autre
part, pousser les recherche et développement d’autres ressources d’énergie.
Tout aussi gratuit est le regret qu’on n’ait pas partagé grand chose avec le
monde pauvre pour freiner sa frénésie à s’industrialiser. La Révélation
d’Arès le rappelle : La larve en se hâtant rejoint-elle l’abeille
(24/2) ? Si l’abeille que nous sommes avec nos superbes
industries voulait éviter que la larve du tiers monde se hâte et
crée un problème énergétique insoluble à rapide échéance, il n’y avait qu’un moyen :
Ne pas progresser trop vite chez nous et partager nos progrès avec la larve. L’abeille ne l’a pas fait ou n’a pas pu le faire du fait d’un effet
d’entraînement trop fort pour être ralenti. Aucun de ces regrets ou de ces
souhaits ne nous mène loin pour le moment.
|
|
| |
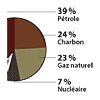
 Plus de 90% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine non renouvelable. Plus de 90% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine non renouvelable.
|
|
La consommation de pétrole ne
sera pas ralentie par des lois ou d’autres décisions réglementaires. Seuls la
pénurie et les prix exorbitants qui en résulteront autoréguleront le débit de
pétrole, les derniers temps avant que les puits soient secs. Même si de
nouveaux gisements pétroliers sont régulièrement découverts, une humanité en
cours d’industrialisation générale utilisera toujours plus de pétrole qu’elle
n'en trouvera — Souvenons-nous de ce qui est arrivé pour le charbon.
L’AIE (Agence Internationale
de l’Energie) affirme dans son dernier rapport annuel que les ressources
prouvées en pétrole sont d’une quarantaine d’années. Et encore, au rythme
actuel de leur exploitation. Comme cette exploitation ne pourra qu’augmenter
les réserves du sol en pétrole devraient durer moins longtemps. Ce chiffre est
évidemment controversé, jugé pessimiste par certains, optimiste par d’autres,
mais considéré par les analystes sérieux comme une moyenne vraisemblable. Ce
chiffre variera probablement, mais imprévisiblement, en fonction des résultats
de la prospection pétrolière, du progrès des techniques de forage et
d’exploitation —notamment l’exploitation des ressources d’hydrocarbure (boues
pétrolifères, etc.) dont le coût d’exploitation est pour l’heure encore trop
élevé — et des variations de la consommation par le développement d’énergies de
remplacement, surtout l’énergie nucléaire, très probablement. De toute façon,
le tarissement du pétrole va survenir.
Nous avons déjà évoqué la
légitime créativité humaine comme cause du tarissement de cette énergie d’un
emploi si commode. Inévitable créativité, puisque le Créateur donne à sa
créature humaine l’image et ressemblance de sa propre créativité.
Matériellement, il lui donne même plus : tout pouvoir sur la création,
donc sur toutes ressources d’énergie (Genèse 1/28, 9/7). Vu comme don du
Créateur, le pétrole nous paraît tout à coup un liquide moins puant, moins
salissant, et ses sous-produits, gaz, essence, mazout, moins asphyxiants et
dangereux. Ce symbole du grossier matérialisme devient une manne, parce
que c’est d’un animal matérialiste pensant, l’homme (Rév. d’Arès VII/1-5),
que le Créateur fit son premier fils, Adam (2/1). Chacun de nous,
utilisateurs de pétrole, est ainsi fils spirituel du Père de
l’univers (Rév. d’Arès 12/4), de l’univers qui n’est lui-même qu’un immense
champ d’énergie continuellement consommée.
Le Créateur décrit sa propre
créativité, perpétuelle consommatrice d’énergie et perpétuelle régénératrice de
cette énergie : Le jour où le soleil est épuisé, éteint, dispersé
comme plumes…, je cours encore et pendant ce temps à travers
l’univers je fais mille nouveaux soleils… Ma main passe, elle éteint les
soleils, en fait de la boue, mais elle couvre le frère conscit, celui qui a trouvé la conscience spirituelle, qui pousse les feux des
cieux comme les feux de l’esprit… (Rév. d’Arès XXII/12). Par ces mots aussi
surprenants que sublimes La Révélation d’Arès dit que la quête des
ressources matérielles n’est pas incompatible, chez l’homme de conscience, avec
la quête des ressources spirituelles. C’est une invitation de plus à pousser la
réflexion sur les ressources pétrolières au-delà de ses aspects matériels.
|
|
| |
.
|
|
Notre consommation
énergétique n’est nulle part dans la Bible vue comme un gâchis, puisque la terre
et ses ressources nous sont données sans condition. Elle est cependant un aléa
de notre existence qui, par la raréfaction et la disparition cyclique,
prévisible, inévitable, de certaines ressources — bientôt le pétrole, même si
on se met à l’économiser — force régulièrement l’homme à évoluer, à remettre
son confort en question. En réfléchissant à cette évolution nous voyons d’abord
le lien étroit qui relie le prévisible tarissement pétrolier et la culture qui
domine actuellement l’humanité.
Dans les faits cette culture
répond bien à l’intention qu’avait le Créateur en créant l’homme : Croissez
et pullulez (Genèse 1/28). En se multipliant, l’homme multiplie les
estomacs, les cerveaux, les désirs et les créativités. Il en arrive
immanquablement, et normalement, à beaucoup consommer.
Dans ses orientations, par
contre, cette culture depuis le mauvais choix d’Adam (Rév. d’Arès 2/1-5) s’est
réduite à une culture de croissance du seul échafaudage économique.
On a oublié que l’échafaudage, dont parle La Révélation d’Arès
(7/2-4), n’a qu’un seul but : la construction du vaisseau spirituel
— Ne pas confondre le spirituel avec la religion, laquelle met l’espoir sous
tutelle, ce qui explique qu’elle soit l’origine et l’alliée de la politique,
qui met la vie quotidienne sous tutelle —. La poursuite exclusive de la
réussite économique aboutit au matérialisme institué, qui tolère la
cohabitation du religieux, mais s’interdit toute extension spirituelle. La réussite
économique réduite à elle-même, vue comme unique principe conducteur de
l’existence, semble faire de la création tantôt le combustible d’un gigantesque
incendie d’énergie et de matière, tantôt le gigantesque apéritif d’une faim qui ne fléchit jamais (Rév. d’Arès 26/5 & 10). Or, l’intention qui
sous-tend la création est autre chose, bien évidemment. La création a notamment
d’innombrables ressources, beaucoup encore insoupçonnées, que la poursuite
exclusive de la réussite économique, qui ignore l’idée même de création, rend
l’homme incapable d’apercevoir. Ce n’est pourtant pas faute d’informations,
trouvées dans l’Écriture. Encore faut-il la lire et, avant de la lire, admettre
qu’elle constitue une source aussi respectable que d’autres sources dont l’Histoire
parle avec le plus grand sérieux. La Révélation d’Arès — source non
seulement sérieuse, mais avérée, puisque son témoin vit encore — dit bien que
l’homme a pour vocation d’ajouter à son inspiration matérielle, légitime
puisqu’il est lui-même matière, l’inspiration spirituelle. C’est de ces deux
inspirations mêlées que naît une troisième inspiration, celle du bien. Alors l’âme se développe (Rév. d’Arès Veillées 17 & 18), l’homme anoblit son potentiel créateur. Il peut ouvrir les yeux sur nombre de
ressources de la terre, qu’il ne voit pas autrement, et la pullulation démographique,
actuellement celle d’une chamelle toujours grosse (Rév. d’Arès 2/3), de
plus en plus problématique, peut devenir une prophétie bénéfique : De
l’humanité matérialiste qui, un jour, manquera de tout, peut se dégager
l’humanité spirituelle qui ne manquera de rien.
|
|
| |

 C’est
en nous interdisant tout préjugé, et donc avec amour pour les matérialistes,
que nous devons replacer la question de la pénurie du pétrole — et, un jour, la
pénurie plus générale de toutes les ressources (Rév. d’Arès XXVI/8) —, en méditant sur la bonne façon de l’envisager. C’est
en nous interdisant tout préjugé, et donc avec amour pour les matérialistes,
que nous devons replacer la question de la pénurie du pétrole — et, un jour, la
pénurie plus générale de toutes les ressources (Rév. d’Arès XXVI/8) —, en méditant sur la bonne façon de l’envisager.
|
|
Le désir de consommer
s’égare, s’il résulte uniquement de séductions au mauvais sens du mot (Rév. d’Arès 27/5), non parce que l’objet matériel de la consommation est
mauvais en soi, mais parce que l’intention qu’y met l’homme n’honore pas cet
objet comme merveille créée, comme chose dans laquelle le créateur a mis son
amour.
Le désir de consommer ne
s’égare pas, même fait de ce confus mélange de besoin fondamental, d’envie de
posséder davantage et de peur de manquer, que tout homme connaît plus ou moins,
s’il, ce désir, vise seulement à rechercher, apprécier et défendre le bonheur
pour lequel l’homme a été créé. Bonheur dont la première part est son partage
avec le créateur. L’homme a été créé pour le bonheur, et tout ce qui prétend le
contraire n’est que mysticisme ou ascétisme.
Par contre, l’homme
déspiritualisé sort de ce cadre précis du bonheur, y compris du bonheur que
donne le pétrole, quand il ne distingue plus entre la nourriture de son espèce
(Rév. d’Arès 4/10), qui est d’abord spirituelle, et d’autres choses qui ne
sont plus nourritures, mais ces artifices, illusions, faux dieux, dans lesquels
le paganisme a toujours été pétri. Autrement dit, il y a un culte païen du
pétrole, et ce dieu manquera au païen, comme les dieux de l’olympe, quand il en
aura le plus besoin.
C’est pourquoi, bien que non
insensible à l’amour, à la liberté, à la beauté (Rév.
d’Arès 12/3) du fait de sa nature divine rémanente, l’humanité
déspiritualisée traite le fruit de la terre— le pétrole est un fruit tardif des
immenses forêts de la terre — non en nourriture, mais en proie
qu’elle dévore (15/3). Peut-être ne fait-elle ainsi que combler un manque
profond, qui la creuse de l’intérieur, comme une lancinante et douloureuse
plaie. Maladie qui vient à l’espèce humaine par manque de vie spirituelle comme
l’anémie vient par manque de globules rouges. L’homme déspiritualisé taille
à droite et a encore faim, dévore à gauche et n’est pas rassasié sans
comprendre qu’il dévore la chair de son propre frère (Isaïe 9/19), ignorant qu’il dévore sa propre nourrice, qu’il se nourrit de pain (de manne) sans voir dans le pain comme dans l’homme qui le mange l’intention
qui a mise le créateur (Deutéronome 8/3). Sa déficience à prolonger le sens
matériel de la vie par son sens spirituel conduira l’humanité déspiritualisée,
majoritaire, à manquer de ressources terrestres, à tout le moins des ressources
qu’elle veut, comme elle les veut, car ce manque sera fictif en fait. La
fiction de la pénurie, quand elle est vue du seul point de vue matérialiste,
est difficile à développer dans un petite publication comme Frère de l’Aube. Disons cependant que cette déperdition du sens des ressources de la terre
répond à la déperdition énergétique personnelle de l’homme, le gaspillage de
ses propos ressources corporelles par l’agitation, l’éclatement intérieur ou
l’enfermement en soi. On retrouve là la conséquence logique du péché, qui
conduit à l’épuisement de la vie et finalement à la mort. Tout, y compris la
question du pétrole, a un sens métaphysique et, par enrichissement de la
pensée, un sens spirituel.
Lorsque le créateur fait
jaillir la richesse et la puissance des sables du désert (Rév. d’Arès 2/9),
claire allusion au pétrole des déserts d’Arabie, de Libye, d’Algérie, d’Irak,
son intention, et son souhait, est que l’homme mette cette richesse et
cette puissance au service de l’accomplissement, inséparablement
spirituel et matériel, de toute l’humanité. Mais l’homme a-t-il complètement
négligé la signification spirituelle, donc généreuse et équilibrante, du projet
créateur ? Puisque, comme déjà dit, on ne peut reprocher à l’humanité
d’avoir utilisé le pétrole, comme d’autres ressources, pour développer ses
capacités de puissance et de jouissance matérielles, puisqu’elles lui ont été
données, peut-on lui reprocher d’avoir trahi sa vocation de bonté en le faisant
dans un esprit de rivalité et d’égoïsme ? Ici aussi la réponse est
difficile, parce que le premier qui a inventé quelque chose ou qui a eu l’idée
de l’exploiter donne toujours l’impression d’avoir agi par égoïsme à l’égard de
ceux qui n’y avaient pas pensé avant lui. Ce serait juger les
matérialistes— Tu ne jugeras pas (Matthieu 7/1) — que de dire que l’huile va leur brûler les bras (Rév. d’Arès XVI/16) en voulant dire qu’elle va
leur brûler le cœur. La responsabilité de l’exploitant ne serait évidente que
s’il était sciemment enfermé dans un matérialisme calculé, sans-cœur et
exclusif, et s’était rendu volontairement myope face à l’avenir du monde. C’est
en nous interdisant tout préjugé, et donc avec amour pour les matérialistes,
que nous devons replacer la question de la pénurie du pétrole — et, un jour, la
pénurie plus générale de toutes les ressources (Rév. d’Arès XXVI/8) —, en méditant sur la bonne façon de l’envisager.
|
|
| |
|
|
L’humanité est peut-être
parvenue à une étape importante de sa trajectoire historique. Pour la première
fois, ses moyens scientifiques et technologiques lui donnent la capacité de
trouver à de grandes profondeurs, d’extraire et de transformer plus de ressources
que la planète ne peut apparemment en fournir, à un rythme qui, vu
l’impossibilité de les renouveler, fait craindre l’impossibilité de les
remplacer par d’autres ressources. Pour la première fois, la boulimie d’une
humanité au ventre rendu béant par une faim toujours insatisfaite (Rév. d’Arès XXII/8), réduit considérablement toutes les prévisions,
rend l’avenir hypothétique. Produire et consommer ne sont pas des actions
mauvaises en soi, puisqu’il faut bien fabriquer et vendre pour fournir du
travail et financer le social, mais deviennent préoccupantes quand, emportée
par une sorte de surenchère idéologique, elles se muent inconsciemment en une
sorte de religion — Le culte d’avoir deux chaises pour une jambe, deux lits
pour une nuit (Rév. d’Arès V/7) —. L’humanité en vient à redouter la
pénurie d’énergie comme des croyants redoutent de manquer de sacrements. Les
pays matériellement riches — 2O% de la planète — se persuadent que leur niveau
de vie et de confort, 80% des ressources terrestres, la crème de la terre
(XXII/14, 28/18), les récompensent de leurs vertus : travail,
inventivité, intellect, science, etc. Mais, comme nous l’avons vu, cette
situation touche à sa fin ; d’autres nations accèdent à
l’industrialisation. Des géants démographiques comme l’Inde ou la Chine vont
s’aligner sur le mode de vie occidental. Les ressources de la terre apparemment
n’y suffiront pas. De plus, les rivalités croissantes pour l’accès aux ultimes
ressources et aux débouchés commerciaux, la crainte de perdre leur niveau de vie
matériel pour les uns, le désir de bénéficier des mêmes privilèges pour les
autres, vont multiplier les tensions politiques et pourront conduire à des
conflits graves, dont l’actuel conflit en Irak n’est peut-être qu’une prémisse.
|
|
| |
|
|
À première vue, on peut
penser que, pour éviter l’impasse où nous mène l’épuisement des ressources, les
pays nantis aujourd’hui ou nantis demain — ceux dont les marchés abondent ou
abonderont en produits —, doivent procéder à une réduction progressive de leurs
production et consommation. Inciter les nations à la sobriété, fondée sur une
forme de frugalité librement consentie par chaque citoyen, cela semble le bon
sens même. Seulement, comme nous l’avons vu, ce n’est pas applicable par la
raison seule et pas davantage par la loi. De toute façon, remplacer un matérialisme
gourmand par un matérialisme sobre n’aboutit jamais qu’à ralentir l’épuisement
des ressources. Le matérialisme est toujours là, les ressources s’épuisent de
toute façon. Ce n’est pas vraiment changer d’esprit et de nature. Or, La
Révélation d’Arès dit : La vérité, c’est que le monde doit changer
(28/7) —, autrement dit, il faut passer à tout autre chose. Il faut changer l’homme par un autre homme.
Pour bien comprendre gardons
à l’esprit deux choses : La première est que le créateur n’a pas pu donner
à la créature un habitat, la terre, si celle-ci ne recelait pas toutes les
ressources nécessaires à la vie. La seconde est que l’estomac, même l’estomac
de l’homme hautement spiritualisé, devra toujours être rempli. Sa sensibilité
au froid demandera toujours du chauffage, même après le Jour de la
résurrection. Ce Jour-là les hommes ne deviendront pas de purs esprits,
ils ressusciteront avec leur chair, leurs estomacs, leur sensibilité,
leur créativité. Tel est l’homme, au commencement comme à la fin des
temps : corps, esprit et âme (17/7). Cette situation ne sera
vivable que s’il y a eu entre temps changement de nature :
transfiguration. La Parole d’Arès nous en donne la recette : la pénitence, qui n’est ni remords, ni tristesse, ni mysticisme, mais retour au Bien. Autrement
dit, il n’y a de solution à la peur de la pénurie qu’existentielle.
|
|
| |
|
|
Contrairement à ce qu’ont
enseigné quantité de courants ascétiques, chrétiens ou non, le Père de la vie
spirituelle ne prône pas le mépris de la consommation matérielle, ne valorise
pas le dénuement, l’abstinence ou même seulement la restriction en tant que
tels, en fait moins encore des vertus. Chacun est libre de consommer ou non.
Abraham, l’ami de l’Éternel, n’était ni un ascète ni un pauvre. La vie
spirituelle n’a de signification que mise concrètement au service de l’amour
bâtisseur et du bien actif, mais non au service de la privation — « Le
renoncement à la profusion matérielle n’a de sens que lorsqu’il faut
impérativement partager », frère Michel, Le Pèlerin d’Arès 1993-96, p.438.
En attendant que cet esprit de partage devienne
« impérativement » évident à tous ou, si l’on préfère, que la mission
des Pèlerins d’Arès et d’autres qui poursuivent le même but spiritualise assez
d’hommes — le petit reste — pour obtenir un changement sensible
de la nature humaine, la pénurie d’énergie forcera l’homme bon gré mal gré a
devenir économe. Pas besoin de tirer des plans pour ça. Ça s’imposera de soi.
La réorganisation du corps social et laborieux se fera d’elle-même. Puisque
nombre de services et de biens de consommation actuels ne répondent pas à des
besoins essentiels, servent surtout à donner du travail à ceux qui les
produisent, ils disparaîtront les premiers tout naturellement. Mais cette
pénurie ne passera pas sans présenter des problèmes humains délicats, des
souffrances, probablement de pénibles troubles politiques et sociaux.
Tant que des hommes en nombre
suffisant — petit reste — ne seront pas capables de surmonter leurs
inquiétudes primaires (Rév. d’Arès XXII/14-16), tant qu’ils n’auront pas
assez de foi pour chercher d’abord le royaume et la justice (Matthieu 6/31,
Rév d’Arès 28/24-26), c.àd. ce qui est juste = le vrai
(II/8-9) et seulement ensuite la justice au sens juridique, la promesse du Sermon sur la Montagne ne sera pas accomplie, le surcroît ne leur sera
pas donné en abondance. La Création peut nourrir sans difficulté
l’humanité, comme elle nourrit les oiseaux ou habille les fleurs des
champs (Matthieu 6/25-34), mais les besoins resteront un problème permanent
tant qu’un petit reste (Rév d’Arès 24/1) ne sera pas devenu spirituel,
fraternel, transfiguré ou en voie de transfiguration. Alors, seulement alors,
des ressources énergétiques aujourd’hui insoupçonnées deviendront infinies et
perpétuelles (Rév d’Arès XXXV/17-20).
Frère Thierry
|
|
|